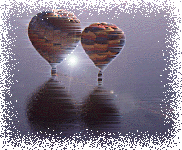
Ils ont osé !
Sur cette page figurent quelques récits de vols qui présentent un caractère un peu particulier: survol de la manche, du mont-blanc, ...
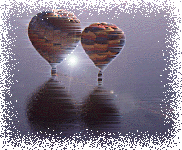 |
Ils ont osé !Sur cette page figurent quelques récits de vols qui présentent un caractère un peu particulier: survol de la manche, du mont-blanc, ... |
 Retour au début
Retour au début
| Au début du siècle, James Gordon-Bennett, directeur du New York Herald, souhaite encourager le développement aéronautique. La première course à laquelle il donna son nom fut celle des ballons libres à gaz : le but est de parcourir la plus grande distance. Cette compétition domine l'aérostation sportive de 1906 à 1938, date à laquelle elle fut interrompue par la guerre. Cette course de ballons donne lieu à de fabuleux vols. La première coupe Gordon-Bennett prend place le 30 septembre 1906 au décollage du jardin des Tuileries, à Paris. Longtemps après la guerre, en 1982, la Gordon-Bennett reprend vie avec un décollage place de la Concorde à Paris. |

|
La plus longue distance
fut parcourue par les français Maurice Bienaimé et Rumpelmayer en 1912 (2191km). C'était
aussi la seule victoire française jusqu'à ce jour. En septembre 97, deux français, Jean-François
et Vincent Leys, remportent la course après 1732,5km en 45h30mn de vol. Voici le récit de leur aventure ... À oui, dernier détail, c'est d'une ville du pays des vaiqueurs que part la Gordon-Bennett de l'année d'après, alors pourquoi pas Paris et la place de la Concorde ? |
Nous venons de vivre une de nos plus extraordinaires aventures aérostatiques, en remportant la course Gordon Bennett : 1732Km en 45 heures 30.
Tout est parti des lectures de jeunesse, des récits presque incroyables d'Ernest Demuyter, du Comte Henry de le Vaulx, de Charles Dollfus. À 12 et 15 ans, on rêve, même plus tard, et l'idée d'une aérostation riche, pleine de surprises, d'aventures, nous est alors apparue. Ce rêve a bien sûr orienté notre pratique vers les longs vols, la durée, la distance. Le choix du matériel, que se soit en air chaud ou en gaz suit la même logique. En 1979, nous construisons au sein du Club des ballons libres du Nord notre premier ballon : "Le Point d'Exclamation", 18 ans plus tard, "Le Petit Prince" de 1050m3 sort de la salle à manger ; il est conçu pour la course : enveloppe légère, filet ultra léger (11 Kg ! Dyneema de chez Cousin Frère à Wervicq), nacelle à plancher nid d'abeilles, etc... On le sait plus léger que le plus léger des ballons de chez Worner (constructeur de référence allemand).
La décision de faire équipe à deux, Vincent et moi, s'est prise naturellement ; notre entente en nacelle étant excellente, l'analyse des situations souvent très proche. Plusieurs vols de plus de 20 heures dont un en partant à Metz jusqu'à Vienne en Autriche sont très prometteurs. On sent qu'avec un ballon de ce type, il y a moyen de faire de belles balades.
En septembre 1996, participation aux Championnats du Monde, avec près de 800 kg de lest à chaque décollage. Certaines épreuves se font en pleine journée, la corde de soupape dans une main et la pelle dans l'autre ; on voit malgré les thermiques, des ballons flasques voler dans les basses couches, c'est une nouvelle école !
15 jours plus tard, nous nous rendons en touriste à Warstein, pour assister au départ de la Gordon Bennett 1996 et peut être aussi pour se faire une idée du matériel utilisé.
L'équipement des ballons n'a rien à voir avec le matériel standard. Il faut prendre en compte la durée de l'épreuve, les conditions parfois extrêmes de froid, d'humidité (pluie), la nuit, le soleil, les communications, l'oxygène, le canot de survie, etc... bref, rien ne ressemble à l'équipement commun.
Un an a à peine suffit pour préparer notre arrivée à Warstein le 6 septembre 1997. Les ballons modernes à ralingues sont maintenant majoritaires ; plus de filet ni de soupape (panneau parachute). Les ballons sont soit blancs, soit jaunes pour éviter l'échauffement du gaz.
Nous gonflons notre Petit Prince en épervier, selon la tradition française. Bien sûr, cela demande beaucoup de manutention, mais le plaisir pour notre équipe est bien là. C'est un peu un rituel ce gonflement, un prélude incontournable avant l'envol, et cela n'est jamais perçu comme une contrainte. Puis tout s'enchaîne vite entre les briefings, les contacts météo avec Joseph qui nous propose déjà le sud de la Roumanie, et même Istanbul si nous le désirons. Il y a aussi le montage du panneau solaire sous l'oeil attentif de notre ingénieur Xavier Waymel, et le chargement de centaines d'éléments dont la check list a été maintes fois vérifiée avant le départ de Lille.
L'envol a lieu à partir d'un podium au son de la Marseillaise le dimanche 7 septembre à 20h36. Il fait déjà nuit. La direction est d'emblée excellente, le vent a 18 noeuds. Nous restons assez bas à 1000 m d'altitude, sachant que le relief peut s'élever à 800 ou 900 m, nous restons très vigilants. Voler bas nous permet en outre d'économiser du lest, et aussi d'avoir un cap 95°, dès que l'on monte ça prend trop de droite (105°).
Nous savons qu'il faut partir le plus à l'est possible, le vent annoncé devant tourner au 120/130° en Slovaquie, il faudra à ce moment se situer suffisamment au nord de la Yougoslavie, interdite de survol, pour pouvoir l'éviter. A l'opposé, il ne faudra pas aller en Ukraine également interdite.
Lundi 8 septembre, huit heure du matin, Sud/ouest de Prague. Pas de problème pour le transit, chaque ballon a un code transpondeur et le trafic en Tchéquie n'a pas l'air d'être trop chargé. Vers 14h, les nuages se dispersent, nous permettant de voir de grandes étendues de champs et de forêts.
18h, entrée en Slovaquie avec le coucher du soleil sur les montagnes, et déjà changement très net de la direction, trop vers le sud, ce qui nous fait penser pendant quelques minutes qu'il faudra se poser de nuit à la frontière Yougoslave avec un vent de 25 noeuds ! Moment un peu chargé d'émotion. Nous décidons de remonter à 3000 m pour évaluer le cap, qui, heureusement, est resté bon (120°) ; le vent pousse à 25/28 noeuds.
Cette réaccélération nous rassure, il sera en effet peut être possible de se poser au sud de la Roumanie avant le coucher du soleil, le lendemain. Nous avons pu en fin d'après-midi contacter par téléphone Joseph et l'équipe de météo Dijon, ainsi que le retrouving qui est déjà en Autriche ; ils se dirigent vers la Hongrie, à un rythme d'enfer ( 4h d'arrêt la 1ère nuit, 4h la 2ème et pas d'arrêt la 3 ème nuit !). L'ambiance dans le camion est excellente ; tout a été prévu avec les couchettes, les réchauds, frigo, téléphone, caisse à outils qui s'est vite avérée indispensable ; les essentiels : passeports et la lettre de l'organisation, traduite dans toutes les langues des pays traversés, demandant d'aider le camion dans sa mission. Cette lettre " magique " a été d'un grand secours à notre équipe de retrouving dans sa traversée de la Roumanie.
La 2ème nuit en nacelle est magnifique, étoilée. Il fait -4° à bord, je m'endors quelques heures malgré une sinusite. Le ballon consomme très peu de sable, il faut juste compenser le refroidissement du gaz et la rosée qui se dépose sur l'enveloppe. Le vent ne faiblit pas.
Nous venons de passer les 1000 Km, mais cela ne nous touche pas, notre esprit est déjà de l'autre coté de la Roumanie. La grande difficulté du passage Slovaquie/ Hongrie a été maîtrisée. Le lever du soleil a lieu à 100 Km au nord des Carpates, le ciel est rouge, c'est impressionnant de beauté. On sort la caméra, puis on déjeune : Corn Flakes, lait, cake.
On regarde avec amusement les 20 Kg de nourriture dans la caisse ; on en a à peine consommé 1,5 kg ! L'esprit n'est pas au gueuleton mais au cap, toujours au cap qu'il faut surveiller. Nous cherchons toujours à prendre maintenant de la gauche. Les Carpates se rapprochent, on les voit encore peu car une épaisse couche de strato-cumulus les surplombent.
Nous surfons sur ces nuages, peut-être, sûrement même, un peu trop bas car une dégueulante à 6 m/s nous réveille instantanément de nos pensées. A 60 km/h, à peut être à peine 300 m des sommets, ça n'est pas très étonnant ! 25 kg de sable, puis de nouveau 12,5 kg sont jetés. Le ballon remonte enfin, après avoir été bien secoué par un rotor qui, en air chaud, aurait sûrement été fatal. Le petit Prince remonte à 4900 m. Nous décidons ensuite de redescendre à 4 m/s, le cap n'en n'est que meilleur !
Vers 11h du matin, nous pouvons doucement descendre dans l'immense plaine du Danube (grands champs géométriques de plusieurs dizaines de kilomètres). Tout l'après-midi est consacré à manoeuvrer. Le ballon se dirige vers le triangle compris entre la Mer Noir et la frontière bulgare, à l'extrême sud de la Roumanie.
La Bulgarie est interdite de survol, c'est éliminatoire. Nos ballonnets nous indiquent des vents plus à gauche dans les basses couches ; on laisse descendre le ballon à plusieurs reprises en basse altitude, complètement flasque ; ces manoeuvres sont bien sûr délicates.
L'approche, à 8 km de la cible que nous nous étions fixé, derniers mètres de Roumanie avant la mer et la Bulgarie, est correcte à50/100 m sol, jusqu'à un virement de plus de 20° de cap (incidence des vents de mer ?..) nous faisant remonter sur la ville de Mangalia. Nous voyons à ce moment à la jumelle 2 ballons près du village Vama veche et seule une remontée rapide peut nous réaxer.
A 6 Km de l'eau, nous délestons 3 sacs pour monter à 6 m/s jusqu'à 2500 m où nous stoppons la montée. Cap 156, 28 noeuds. Nous décidons ensuite de descendre à 4 m/s. L e taux de descente optima est jugé à l'oeil en fonction de notre arrivée sur le site . Le ballon hollandais nous parait être en Bulgarie, le ballon américain, déjà posé, nous sert de guide et nous décidons de nous poser plus au sud et plus à l'est que lui.
Le guiderope est lâché à 30 m du ballon américain de David Lévin et Mark Sullivan et après 200m de guideropage, le panneau est tiré.
La mer est à 50 m de la soupape ! Le mirador de la frontière Bulgare à moins de 300 !
Quel vol ! Il est 18h03, le soleil vient juste de se coucher et la Mer Noire est à nos pieds. Tout s'est bien passé, on ne se rend pas bien compte, Vincent et moi, de ce qui nous arrive.
Notre ballon et le ballon américain sont chargés ensuite à bord d'un camion, pour être menés à l'hôtel de la petite cité balnéaire. Les américains, avec qui nous partageons le repas du soir, sont un peu blêmes de s'être fait battre de 226 m.
Le lendemain matin, mercredi 10 Septembre, 6 h, le camion est face à l'hôtel, alors que nous n'avions même pas donné notre position ! Laurence et Isabelle Leys, Mireille et Xavier waymel, Jean Chenevière et notre observatrice américaine Connie Thompson y dorment. Ils viennent de vivre, eux aussi, une grande aventure, avec un parcours truffé de pièges sur les routes roumaines.
Après relèvements en commun des positions d'atterrissage, nous avons quitté l'équipe américaine pour reprendre rapidement la direction de l'occident. Seule une pause de 6 h a été prise durant les 2450 km de retour
Merci à toute cette merveilleuse équipe du CBLN, aux amis du ballon qui nous ont aidés dans divers domaines (cartes, barographe, Fly Tech, etc...). Grand merci à Joseph Mazoire et toute l'équipe de Dijon qui, une fois de plus, nous a montré sa compétence et son enthousiasme à travers tout le routage.
Merci enfin à Cousin Frères Wervick qui a été à notre écoute et nous a apporté une aide précieuse dans nos recherches techniques.
Nous tirons un grand coup de chapeau à l'équipe de l'aéro-club allemand qui a organisé cette course avec un professionnalisme et une précision exemplaires.
Jean François Leys
N.B : Bienaimé et Rumpelmayer étaient, jusqu'à cette année, les seuls français à avoir remporté cette légendaire épreuve, c'était en 1912. Il sont d'ailleurs toujours détenteurs du record de distance sur cette compétition : 2191 Km en 45 h 42. Le record de durée, toujours sur cette épreuve, est détenu par les allemands Eimers et Landsman qui en 1995 ont parcouru 1628,11 Km en 92 h 11.
 Retour au début
Retour au début
Pour la première fois, en 1992, une compétition
a emmené cinq ballons au-dessus de l'Atlantique. L'objectif,
traverser l'océan. Le vainqueur sera le pilote qui touchera
le premier le continent européen. L'équipage belge
remporte cette première course transatlantique en se posant
en Espagne.
Cinq rozières, c'est-à-dire ballon mixte air-chaud et hélium, ont décollé le mercredi 16 septembre de Bangor, dans le Maine aux États-Unis pour la première course transatlantique en ballon. Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté, au petit matin, au départ des cinq équipages (allemand, américain, anglais, belge et néerlandais).
En dépit des équipements sophistiqués embarqués à bord, la traversée est toujours considérée comme extrêmement dangereuse. Sur les 16 tentatives de traversée de l'Atlantique en ballon, seulement 5 ont abouti, cinq autres se terminant en tragédie. La première traversée victorieuse, déjà au départ de Bangor, a été réussie en 1978 par le pilote américain Ben Abruzzo à bord du ballon "Double Eagle II". D'ailleurs, pour ce nouveau challenge, sponsorisé par la marque de voiture américaine "Chrysler", le fils de Ben, Richard Abruzzo, faisait partie de l'équipage américain.
Pour cette première course, tous les ballons en compétition ont été fabriqués par la firme Cameron de Bristol en Angleterre. Leur enveloppe en Kevlar gonflée peut atteindre 30 mètres de hauteur et évoluer jusqu'à 8000 mètres d'altitude où la température ambiante peut descendre jusqu'à moins 40 degrés.
Le départ a été donné le 16 septembre à 7h (TU) et les concurrents prirent un cap Est-Sud-Est. L'altitude de vol s'est située entre 1000 et 15000 pieds. L'arrivée du premier ballon "Crysler 1" se fit à Pèque dans la province de Zamora en Espagne, à 180 km à l'ouest de Valadolid. L'équipage de ce ballon était composé de Wim Verstraten et de Bertrand Piccard.
Le ballon allemand a dû amerrir dans le 47°N40W, le ballon hollandais a également amerri le lundi 21 septembre dans la matinée non loin des côtes anglaises.
Le ballon anglais, piloté par Don Cameron
a atterri sur une plage au nord de Lisbonne au Portugal. Il se
place second. Quand au ballon américain, il a terminé
son vol beaucoup plus tard sur la côte Nord-Ouest du Maroc,
non loin de Casablanca.
Classement:
1er: Belgique avec Wim Verstraeten et Bertrand Piccard, 122 heures de vol et 4930 km parcourus.
2ème: Grande-Bratagne avec Don Cameron et Rob Bayly, 125 heures de vol et 4822km.
3ème: USA avec Troy Bradley et Richard Abruzzo avec 144h16 de vol et 5063km (alors nouveau record du monde de distance, battu depuis, mais le record de durée de 144h16 n'a pas été battu.)
Non classés les deux équipages hollandais
et allemands. Erich Kraft et Jochen Mass portaient les couleurs
de l'Allemagne, Gerhard Hoogeslag et Event Louwman courraient
pour les Pays-Bas.
"Aéro-note" 24, 3ème
trimestre 1992
Pour un récit détaillé du vol de l'équipe vainqueur,
vous pouvez lire le livre écrit par Bertrand Piccard.
 Retour au début
Retour au début
Il aura fallu 3h37 à la montgolfière
de Villeneuve d'Ascq, le lundi 6 septembre 1993, pour parcourir
les 39km40 qui séparent le Cap Gris Nez de Douvres, en
Angleterre. Une traversées très rare dans le sens
France - Angleterre. Celle-là même qui avait tué
Pilâtre de Rozier en 1875.
Ils n'en reviennent toujours pas, même s'ils ne qualifient pas leur expérience d'exploit. Tout de même. Dominique Spriet et Christian Delebecq sont un rien fiers d'avoir réussi le pari qu'ils s'étaient fixé lors de la dernière assemblée générale de leur club, celui des "ballons libres du Nord", (installé à Villeneuve d'Ascq et aidé par cette même commune): traverser la manche dans le sens est-ouest, un choix périlleux lorsqu'on sait que les vents portants dans ce sens (vent d'est, légèrement sud-est) sont très rares. Et que s'il y a défaut dans le calcul ... on rate les côtes anglaises. La même traversée a été réussie par les frères Leys avant l'été, mais avec un ballon à gaz. Là, ils ont embarqué dans une montgolfière. Cet exploit, ils l'ont réussi, et ils l'ont raconté à Bondues, près de l'aérodrome, dans le local où dorment les montgolfières.
Depuis plusieurs semaines, ils attendaient le signal, l'appel de Météo-France. Car sans la station de Lesquin, rien n'était possible. Et voilà que le coup de fil est arrivé à Hem, chez Dominique Spriet , dimanche dans l'après-midi. Où l'on prévoyait un vent favorable pour lundi, entre 8 et 12 heures. Branle-bas de combat, préparation du matériel et départ de Bondues le lundi matin, à 4 heures. Au sommeil, ils ont préféré l'aventure.
Ce sont les disponibilités de chacun qui ont désigné les partants. Avec, dans la liste des choses à ne pas oublier, 7 bouteilles de propane, une radio VHF, un détecteur radar et un navigateur satellite GPS. Arrivée au cap Blanc Nez, les essais sur petits ballons montrent que les vents risquent de trop les porter vers l'Est. Ils ont décollé du cap Gris Nez. Au sol au départ, Jean-Marc Lequime. Dans un Ferry pour la liaison radio, Benoît Sergent. Et dans le ballon Dominique Spriet, pilote (depuis le 1er mai 1972), et Christian Delebecq, équipier. 9heures du matin, grand beau temps, vent calme, au loin les dernières lumières de Douvres avant le vrai jour, un paysage féerique, et la mer droit devant. "Sur les 2/3 du parcours, il nous a fallu voler entre 5 et 80 mètres au-dessus de l'eau, compte tenu des vents. Mais de là-haut, c'était fantastique, on découvrait le ballet des ferries et d'autres bateaux. Incroyable comme le trafic est dense dans la Manche !". Dominique Spriet n'est pas avare de détails, il y a un rien de passion chez cet homme là ... Un rien qui l'a amené vers les 12h44 au-dessus de Douvres, après avoir tenu durant 3h37 le cap moyen de 328.
L'arrivée à Douvres, avec des bateaux
se prenant pour des maquettes, une côte anglaise abordée
de haut, avec sérénité. Et tout au bout là-bas,
dans le champ de verdure, Benoît Sergent pour les récupérer.
C'est ainsi que Dominique Spriet a réussi sa 652ème
ascension. Celle-ci avait tout de même un goût particulier.
Celui d'un pari qui, loin d'être stupide, fut superbement
réussi.
"Aéro-note" 30, décembre
1993 extrait du journal "Nord Éclair"
 Retour au début
Retour au début
François Ygouf pourra désormais
dire qu'il est le premier Français à avoir traversé
la Manche en montgolfière entre Jersey et le continent.
Évidemment, c'était à bord du "Ville
de Saint-Lô" le 3 juillet 1993.
Mine de rien, c'est impressionnant d'être entouré d'eau à perte de vue. Et même "un peu angoissant", avoue François Ygouf, le pilote du ballon "Ville de Saint-Lô". L'an dernier, au mois de juillet, deux Jersiais, Serge Cuhat et Paul Mac Callum, avaient déjà tenté l'expérience. Avec succès. Mais d'aérostier français au-dessus du passage de la Déroute, il n'y en avait encore eu point. Fidèles des montgolfiades et amis de François Ygouf, les deux pilotes tenaient à ce que la primeur lui soit réservée.
Il ne s'est pas fait prier. Un météorologiste annonçait des conditions météo favorables pour samedi. Vendredi soir, François Ygouf embarquait donc avec le "Ville de Saint-Lô" à Barneville Carteret. Le lendemain matin, le vent soufflait effectivement de l'ouest avec une force d'environ 10 noeuds. Pour éviter les turbulents cumulus, le départ a eu lieu de bonne heure. "à 7 h, heure française", les trois ballons ont décollé du petit port de Gorey sous le regard flegmatique de quelques badauds matinaux. Quelques minutes plus tard, c'était de l'eau à perte de vue. Pas d'autre solution que d'aller de l'avant ... en espérant que la réserve de gaz serait suffisante pour éviter le bain forcé.
François Ygouf avait emporté cinq bouteilles, soit quelques 200 kilos de gaz. "En survolant la tour aux Bœufs, j'ai su que j'étais à mi route, raconte-t-il. Et j'entamais ma troisième bouteille". Autant dire qu'il n'allait pas falloir traîner. "Ce qui est angoissant, au dessus de l'eau, c'est qu'on n'a plus de point de repère". Pour tenter d'estimer sa vitesse, car il craignait de manquer de carburant, l'aéronaute a donc fait descendre son engin à un mètre de l'eau. "Pour voir les masses de goémons flottant à la surface". Et pour constater, malgré les apparences, que le ballon avançait bien.
Quel soulagement tout de même, d'apercevoir enfin le havre de Régneville. "Nous avons parcouru 53 km en trois heures", calcule François Ygouf. Ce qui n'est effectivement pas très rapide. "L'an dernier, ils avaient traversé en deux heures". Un vent un peu plus puissant aurait été le bienvenu et aurait permis d'éviter l'appréhension de la panne sèche. Pas de panique à bord de la nacelle, cependant.
Le pilote a su garder son calme et son passager, un Jersiais dont c'était le baptême de l'air, a pour sa part effectué une traversée tout à fait sereine.
Malgré cette légère anxiété qui ne l'a jamais quitté, l'aéronaute a vécu quelques moments de rêve. Par exemple lorsque les dauphins sont venus danser dans l'ombre de la montgolfière.
Quelques sensations inconnues aussi: "trois
ou quatre secondes après chaque coup de brûleur,
la surface nous renvoyait l'écho".
"Aéro-note" 30, décembre
1993, extrait du journal "La Manche Libre"
 Retour au début
Retour au début
Depuis onze ans, la chaîne des Alpes n'avait pas été traversée du Nord au Sud. Le 28 janvier, bénéficiant de conditions météorologiques exceptionnelles, le pilote, Jean Becker, accompagné de Julien Fath, ont rejoint Milan au départ de Château-d'Oex. 200 km en quatre heures de vol au dessus du Mont-Rose et du Cervin.
Bénéficiant d'un extraordinaire microclimat, la vallée du Pays d'Enhaut, à mi-chemin entre l'Oberland Bernois et le Lac Léman accueille tous les ans au mois de janvier les aérostiers venus tenter la traversée des Alpes. En effet, Château-d'Oex est devenu, au fil des années, la capitale alpine des activités aéronautiques à air chaud. Ainsi, cette petite station de ski des Alpes vaudoises est la première base de montgolfières dans les Alpes. Et cette année, Château-d'Oex a accueilli le championnat du monde de dirigeables à air chaud du 2 au 6 février.
Depuis la traversée de Michel Arnould en 1983, aucun pilote français n'avait tenté ce vol prestigieux en montgolfière. Et jeudi 28 janvier, une vingtaine de pilotes, dont deux français (Jean Becker et Pierre Faton) s'élancent dans le ciel bleu azur pour tenter de parcourir la plus grande distance en ballon. Épreuve unique au monde qui permet, quand les vents soufflent dans la bonne direction, de traverser les Alpes. Un vol impatiemment attendu par la vingtaine de pilotes dont certains ont même traversé l'atlantique ou le Pacifique pour participer à ce rendez-vous prestigieux.
Les ballons s'élancent à 8h30 de Château-d'Oex avec 160 kg de gaz à bord, le matériel informatique de mesures et les radios nécessaires pour correspondre avec les tours de contrôle des aéroports, afin de ne pas gêner le trafic aérien.
Nous mettrons une heure pour atteindre l'altitude de 6000 mètres. Nous sommes à la verticale de Gstaad puis nous prenons la direction de l'Italie. Tous les quarts d'heure, nous respirons à l'aide de nos masques à oxygène, tandis que les contrôleurs de Genève suivent notre vol sur leurs écrans radars.
À 6000 mètres, nous trouvons un vent de 90km/h qui va nous permettre de traverser la barrière alpine et un vent de N/NW nous emmène tout droit en Italie. Nous survolons la vallée de Sion, puis la station de Zermatt. Devant nous pointe le Cervin (4550 mètres) reconnaissable à sa forme pyramidale et sur notre gauche, le Mont-Rose (4600 mètres). Au fond, sur notre droite, le massif du Mont-Blanc. Pour éviter les turbulences dues aux vents violents, nous montons à 6500 mètres, atteignant une vitesse de plus de 100 km/h et passons à la verticale du Mont-Rose. Nous volons une heure à cette altitude et arrivons au-dessus de la plaine du Pô en Italie. Vers 11 heures, nous sommes entre Turin et Milan et nous entamons alors notre descente. Au sol, à perte de vue nous ne voyons que des rizières, mais dernière nous, le panorama est fantastique. Nous admirons la chaîne des Alpes de Nice aux Dolomites en passant par le Mont-Blanc, le Mont-Rose, les Alpes bavaroises et autrichiennes. Un spectacle exceptionnel ... Devant nous, la mer Méditerranée avec le port Italien de Gênes ...
À partir de 2500 mètres, nous n'avons
plus de vent et allons même peiner pour trouver un terrain
propre et sec pour atterrir. Finalement, nous touchons le sol
à 12h30 à 40 km au Sud de Novara. Et c'est immédiatement
l'arrivée des fermiers italiens qui ne comprennent pas,
dans un premier temps, pourquoi nous avons de la neige sous notre
nacelle, alors qu'à 200 mètres de notre point d'atterrissage
poussent des palmiers ... Nous partageons nos souvenirs, autour
d'un plat de spaghettis, avec les agriculteurs de la région.
Notre équipe de récupération arrivera vers
16h30. Si nous avons parcouru 200 km, l'équipe en voiture
à dû rouler durant 350km pour nous retrouver.
"Aéro-note" 31, mars 1994
 Retour au début
Retour au début
Thierry, Vincent et Jean-François Leys ont traversé
la manche en ballon à gaz au départ des côtes
françaises le 23 mai 1993. Récit :
Tout a débuté le samedi 22 mai 1993 par l'envol
de deux de nos ballons à hydrogène, le "Robert
Dévêque" de 248 m3, qui reste le
plus petit ballon "classique" du monde et le "Santos
Dumont" de 750 m3.
Nous sommes accueillis dans un très dynamique village du
Pas-de-Calais, Bénifontaine, de 300 habitants. Le Maire,
Monsieur Félix Fournier a su collecter les fonds pour organiser
le traditionnel lâcher de ballon que nous ne sommes pas
prêts d'oublier.
À 17 heures, les 2 sphériques décollent et
se suivent. Le vent est calme, de 7 noeuds, il nous emmène
vers le Nord-Ouest. Les thermiques, bien présent à
cette heure, nous font consommer près de trente kilo de
sable à l'heure ; il faut monter pour atteindre l'accalmie.
Nous ne quitteront donc les 1200 mètres que vers 19h30,
au niveau d'Aire sur la Lys. L'air est devenu plus calme, le vol
en radada est maintenant possible pour notre plus grand plaisir.
La lumière est superbe. La région boulonnaise est
un peu vallonnée, ce qui nous change du plat pays ; de
plus ni ligne ni usines ne viennent perturber cette ambiance.
Les deux ballons se posent à 21h55 dans une pâture
protégée par une rangée de peupliers, au
fond d'un vallon. L'endroit est idéal pour une escale de
nuit.
Le 250 m3 est dégonflé, reste à
trouver une tonne de sable ou de gravier pour lester la nacelle
du Santos et attendre le lever du jour pour repartir. Nous sommes
à une bonne trentaine de kilomètres de la côte,
précisément à Acquin, près de Lumbres.
La direction semble bonne pour l'Angleterre. Thierry surveille
le ballon tandis que toute l'équipe avec femmes et enfants
repart à Lille pour se restaurer, et surtout prendre l'avis
météo.
1h30 du matin. Vincent est très optimiste. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous prenons carte, transpondeur, radio, quelques livres sterling et des sandwichs préparés à la hâte.
4h30. Retour à Acquin. Le ballon éclairé par les phares est splendide. Nous essayons de dormir, tous n'y arrivent pas, l'excitation est là.
5h55. Les ballonnets d'hélium ont le bon cap, le vent semble de bonne vitesse.
6h05. Santos décolle.
Thierry, Vincent et moi-même sommes un peu émus.
Nous emportons 180 kg de sable à bord d'un ballon, qui
nous le savons, ne consommera pas de lest avant 17 heures. Le
gaz en effet se réchauffe, le ballon sèche, ce qui
allège l'aérostat durant les premières heures
de la journée. Sa couleur blanche limite cependant le réchauffement,
permettant de mieux contrôler l'altitude du ballon. Nous
choisissons le niveau de 1400 pieds pour bénéficier
d'un vent bien établi. Le cap est excellent, la vitesse
est de 14 noeuds.
Au sol, le vent est pratiquement plein est. Tout cela est rassurant,
le plan de vol est déposé par radio. Le transpondeur
est branché. Nous passons par le sud de la forêt
de Guines, là où Blanchard s'est posé en
1785.
7h28. Le Cap Blanc Nez, identifiable à ses falaises, est
sous nos pieds. Le soleil apparaît, la mer est calme, la
visibilité est de dix kilomètres. On y va. La traversée
s'effectue à l'altitude de 500 mètres, sans grande
déviation de cap. A mi-course, les falaises de Douvres
apparaissent dans la brume. Le ballon à tendance à
monter; il faut fréquemment actionner la soupape. Un ferry
parti dix minutes après nous de Calais nous suit sans jamais
pouvoir nous rattraper. Le spectacle à bord du bateau doit
être superbe. Les courant marins sont impressionnants, le
bruit des vagues est tout à fait perceptible. Nous abordons
Douvres à 8h40, soit après 1h10 de traversée.
On s'embrasse.
Le vol s'est ensuite poursuivi pendant plus de 4 heures, avec
le survol de l'Essex, Canterbury et sa cathédrale, l'estuaire
de la Tamise, puis l'aéroport musée de Southen où
sont basés bon nombre de bombardiers de 39/45. À
signaler pour l'anecdote le survol du petit village "Leys
down on sea".
Londres nous autorise à passer par l'est de la capitale,
nous espérons ne pas changer de cap.
A midi malheureusement, le vent vire plein est, imposant l'atterrissage.
Au sol, ça souffle à 40 km/h, avec rafales et instabilité.
Santos passe la ville de Billericay à 100 mètres
du sol, puis le guiderope est lâché et le panneau
tiré. Quelle aventure, quel vol !
La traversée de la Manche est un peu le rêve de tous
les aéronautes de la région, mais il faut tellement
de conditions favorables que les traversées restent exceptionnelles.
La dernière traversée en ballon à gaz dans
ce sens eu lieu en 1924 par Ernest Demuyter et auparavant une
dizaine de ballons partis de la Concorde en 1906 lors de la 1ère
coupe Gordon Bennett.
"Aéro-note" 28, 2ème trimestre 1993
 Retour au début
Retour au début
La semaine suivant le stage des Carroz, les prévisions
météorologiques annonçant un excellent créneau,
trois montgolfières ont joué les prolongations en
vue d'une traversée des Alpes : le ballon Chaize piloté
par Serge Zuin, le ballon Lindstrand piloté par Guy Lefebvre
et le ballon des Carroz.
Le beau temps est annoncé pour vendredi, je contacte la météo de Genève où Gérard Scherer me le confirme et se propose pour la récupération avec son épouse Gisèle. Le vent nord-nord-est est bien au rendez-vous le vendredi 1er mars. Nous prenons l'option de décoller au fond de la vallée du Giffre au cirque du Fer-à-Cheval, magnifique site à 900 mètres d'altitude, cela nous permet d'être bien abrités pour monter sans trop dériver dans les basses couches afin de garder une bonne trajectoire dans l'axe du Mont Blanc.
Huit heures. Ultimes préparatifs, pressurisation des cylindres, chargement des nacelles avec oxygène et matériel de survie, c'est l'occasion de mettre en pratique les enseignements du stage. 9 heures. Je décolle avec mon 3000 m3 "Les Carroz" et Jean-Marc Guérin comme passager, suivi de Serge Zuin seul à bord de son 2600 puis de Guy et Yvonne Lefebvre à bord de leur 3000 m3. Gégé et Gisèle s'organisent pour récupérer les trois engins avec deux véhicules.
La montée s'effectue à trois mètres seconde, je vois au dessous de moi les deux ballons légèrement déformés par l'ascension. À 2500 mètres des stratus nous bouchent le ciel, puis c'est l'émerveillement : droit devant nous, à une vingtaine de kilomètres se dévoile, majestueux, le Mont Blanc. Il nous attend, il semble même accueillant. Notre montée dure encore une demi-heure. À 4500 m, nous inhalons nos premières bouffées d'oxygènes. À 5500 mètres, nous survolons le col du Dôme du Gouter. Comment qualifier le spectacle qui s'offre à nous ?
Soudain Jean-Marc m'alerte : "Regarde le ballon de Serge, il descend !". Vite contact radio : "Serge, Serge pour Jo que se passe-t-il ?". La réponse arrive après de longues secondes : "Jo pour Serge, plus de problème, j'ai eu une extinction de veilleuses pendant un changement de bouteilles mais ça fonctionne à nouveau, je remonte vous rejoindre". Serge a fait 800 mètres de descente froide !
Dix minutes plus tard, Serge survole le refuge Vallot et Guy passe encore plus à gauche sur les Bosses, à quelques centaines de mètres du toit de l'Europe. Après 2 heures de vol et le dépassement de Bourg-Saint-Maurice, j'amorce la descente et 30 minutes plus tard je pose "Les Carroz" chez les concurrents, sur une piste de Peisey-Nancroix. Serge descend à la verticale de Bourg-Saint-Maurice mais le fond de la vallée est "très fréquenté" par les lignes électriques, il fait deux fois "la boîte" en utilisant les brises de pentes déjà fortes sur les versants sud et après trois heures de vol, il trouve, pour se poser, un terrain en contrebas d'une petite route, sur le coteau escarpé de Séez. Guy est resté plus haut que nous, il choisit Les Arcs pour atterrir au sommet des pistes au terme de 2 heures et demi de vol. Une chenillette dameuse lui offre ses services pour le redescendre à la station.
Nos "récup" arrivent. À 15 heures, nous
sommes tous réunis au restaurant de la gare de Bourg-Saint-Maurice
à commenter notre merveilleux vol, devant une première
bouteille déjà vide.
Jo Roulet, "Aéro-note" 40, mai 1996